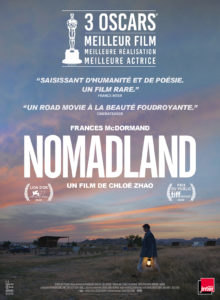27 décembre 2021
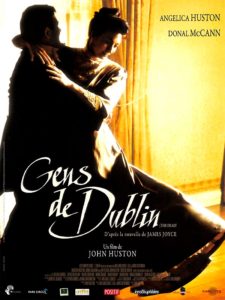
Photo : AlloCiné
Avec Gens de Dublin, John Huston réalise, en 1987, son tout dernier film, un film testamentaire en quelque sorte. Epuisé, le cinéaste décède avant la première. Grand passionné de James Joyce, Huston se saisit de sa nouvelle The Dead pour recréer avec fidélité, une oeuvre d’une élégance, d’un raffinement, mais aussi d’une nostalgie et d’une modestie remarquables, bien loin des vanités que le film démasque.
Nous sommes en janvier 1904. Les soeurs Morkan et leur nièce Mary, reçoivent leurs amis à la réception annuelle qu’elles organisent pour l’Épiphanie. Il y a là le neveu Gabriel (Donal McCann) et son épouse Gretta (Angelica Huston) qu’on verra dans la première partie du film légère et enjouée et plus tard vers la fin en madone diaphane. Il y a Mrs Malins et son alcoolique de fils Freddy, toujours à mettre les pieds dans le plat avec ses remarques drôles et naïves. On entendra chanter le ténor Barteil D’Arcy, vaniteux et rempli d’orgueil suivi du beau poème récité par Mr. Grace. Quant à Mr. Brown, on notera qu’il a toujours un verre de whisky à la main et qu’il est toujours sur le point de s’endormir. À part la jeune Molly, pressée de se rendre à une réunion politique, tout ce beau monde rit, danse, chante au son du piano de Mary, se repait de vin et d’oie farcie, avec une caméra qui balaye les personnages comme dans une chorégraphie vagabonde. On discute de politique, d’art, de religion… de façon superficielle, sans passion.
On évoque sans cesse le passé, qui, nous le savons est définitivement passé et ne réapparait que comme un récit que John Huston nous décrit sous forme d’une succession d’images dont on ne sait trop à qui ou à quel fait précis elles renvoient. Derrière cette apparence légère et festive chacun étouffe le poids de ses petites misères et de ses angoisses existentielles. La mélancolie et la mort flottent sur le festin comme nous le signifie John Huston. Le futur est ainsi évoqué avec cette image où l’on peut voir la plus vieille des deux soeurs sur son lit de mort. Ou lorsque Gabriel récite son discours de remerciements face aux deux vieilles soeurs filmées dans un long plan en plongée, comme paralysées de bonheur et de frayeur à la fois.
Vanité, orgueil, mélancolie, médiocrité, vacuité… tout cela se lit sur le visage des convives. Et la mort aussi peut-être. La couleur du traitement d’une sombre beauté, l’atmosphère grisâtre, le découpage du récit, n’annoncent rien de bon. À l’arrivée des invités devant la maison des soeurs Morkan, c’est l’enthousiasme et l’impatience des réjouissances attendues qui animent ce petit monde. Puis, rideau. À nouveau la façade de la maison comme pour marquer la fin de l’excitation de la fête à venir et le début de cet entre deux ambivalent tout à la fois réjouissant et déliquescent. (On ne peut s’empêcher de penser au film Le guépard de Visconti). Puis encore un plan sur la façade. C’est le troisième temps, celui de la mort.
Si le passé est mort, l’avenir est tout aussi mortifère. Huston nous y avait déjà préparé avec la vieille Morkan sur son lit funéraire. Voici maintenant que Gretta s’en fait le passeur. Tous les convives partent. Gabriel et Gretta les derniers. Sur les marches, Gretta, saisie d’émotion et baignée de lumière s’immobilise en entendant chanter le ténor Bartell D’Arcy. Comme elle le dira à Gabriel plus tard à l’hôtel où ils logent, cette chanson lui rappelle un triste souvenir de sa jeunesse. Elle avait alors connu un jeune homme qui lui chantait cette chanson et qui s’était laissé mourir d’amour pour elle. Culpabilité ? Remords ? Gabriel en est bouleversé. Le temps se vide de son histoire. La passé est passé. L’amour est mort. Huston s’en va. Mais le film reste. Il est là, écrit dans un texte magnifique et dit par des acteurs qui nous émeuvent infiniment.
« Gens de Dublin »
John Huston
USA 1987
Avec Angelica Huston et Donal McCann
Disponible en DVD et Blu-ray
=============================================================